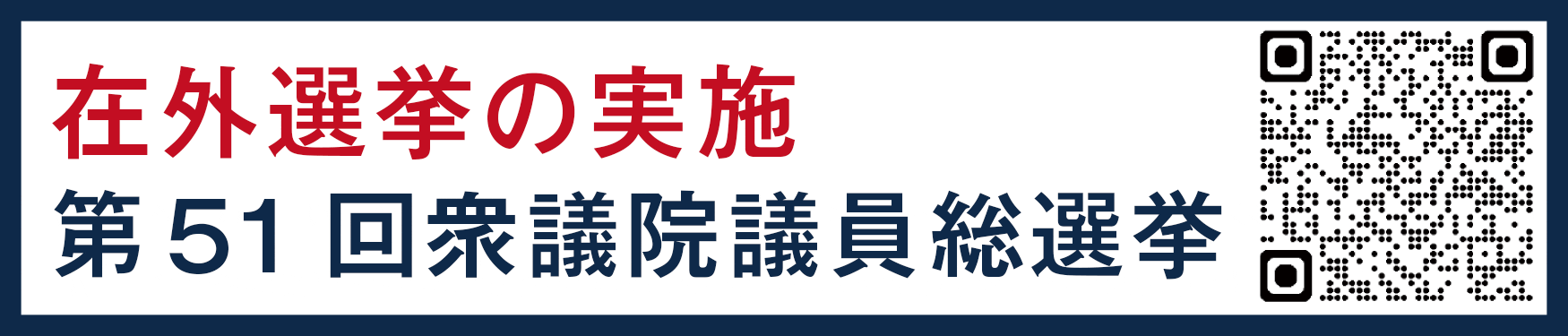Vous dites de vos documentaires qu’ils appartiennent à la catégorie du cinéma d’observation (kansatsu eiga). Pourriez-vous nous dire ce qui se cache derrière cette appellation ?
Vous dites de vos documentaires qu’ils appartiennent à la catégorie du cinéma d’observation (kansatsu eiga). Pourriez-vous nous dire ce qui se cache derrière cette appellation ?
S. K. : En effet, c’est moi qui ai choisi de classer mes films sous ce terme. Mais derrière cette appellation, il y a deux choses importantes.
Tout d’abord, en tant que producteur, il s’agit de faire preuve d’un très bon sens de l’observation et de filmer le résultat. Sans recherche ni arrangement préalables, je me présente avec ma caméra. Pendant le montage, au lieu de chercher à adapter ce que j’ai filmé pour coller au sujet que j’avais prédéfini, j’accorde plus d’importance à ce qui ressort naturellement des prises après les avoir visionnées plusieurs fois. Mon but est d’apprendre à partir de la réalité, en éliminant toute idée d’harmonie préétablie et désir de coller au sujet prédéterminé. D’autre part, je ne veux pas interférer dans le travail d’observation du spectateur. Pour cela, j’ai renoncé à la narration et autre sous-titre. En faisant de longues prises si besoin est, je laisse une marge qui peut être interprétée comme la possibilité laissée au spectateur d’observer librement et activement une scène. Je me suis inspiré du cinéma direct en vogue aux Etats-Unis dans les années 1960. J’ai appris de la théorie et de l’esprit du cinéma direct que j’ai ensuite arrangé à ma sauce pour développer ce « cinéma d’observation ».
Qu’est-ce qui vous a poussé à réaliser ce film ?
S. K. : Quand j’avais une vingtaine d’années, on a découvert que je souffrais du syndrome d’épuisement. J’ai alors pris conscience que tout le monde pouvait être affecté par des troubles mentaux. Dans nos sociétés modernes où les sentiments de frustration et solitude sont très forts, les gens cohabitent avec les maladies mentales. Malgré cela, c’est un sujet qui reste tabou et est entouré de préjugés. Personne ne veut le regarder en face. Conscient de cette situation contradictoire, j’ai voulu aller observer avec la caméra pour casser les barrières. Avec l’espoir aussi que cela suscite un vif débat.
Les maladies mentales ont toujours été un sujet tabou. Je suppose que ça n’a pas été facile d’aborder ce sujet.
S. K. : C’est vrai. Parmi les patients que j’ai contactés pour qu’ils apparaissent dans le film, entre 80 % et 90 % d’entre eux ont refusé d’être filmés. La plupart vivent et travaillent, tout en cachant la nature de leur mal à leur famille ou leurs collègues. Lorsqu’on est malade, être obligé de cacher son mal contribue à accentuer le mal-être. Pour les patients, c’est une double souffrance. C’est un peu comme si vous vous étiez cassé la jambe, sans l’avoir dit à personne, et qu’on vous demande de courir à la même vitesse qu’un individu ayant ses deux jambes valides.
Lorsqu’ils parlent de patients atteints de troubles mentaux, les médias, du moins au Japon, ont recours à des pseudonymes, à une mosaïque pour cacher leur visage. Mais ces artifices font perdre au patient son individualité et son humanité. Il est réduit au statut de « patient ». Dans mon documentaire, j’ai décidé dès le départ de ne pas recourir à la mosaïque. Cela n’a pas été facile à faire accepter aux patients et à leur entourage, car ils étaient très réticents à l’idée d’apparaître à visage découvert.
Comment était l’atmosphère à Chorale Okayama, l’établissement où vous avez planté votre caméra ?
S. K. : Le docteur Yamamoto Masatomo dirige l’établissement Chorale Okayama. C’est un personnage qui met le patient au cœur de l’exercice de sa profession. Lorsque j’ai présenté ma demande pour filmer, il a organisé des « groupes de travail » avec les patients pour qu’ils donnent ou non leur accord. Grâce à cela, ce documentaire est le fruit de leur propre décision et il est devenu « leur film ». A Chorale Okayama, on est loin de l’endroit où l’on « contrôle » le patient. On a plutôt l’impression que c’est un « lieu » que les médecins et les usagers gèrent en commun.
Comment votre documentaire a-t-il été reçu par les personnes qui travaillent dans le monde psychiatrique ?
S. K. : Plusieurs d’entre elles ont été surprises que je puisse réaliser ce film. Certains m’ont dit que dans leur hôpital, on ne m’aurait jamais donné l’autorisation de le faire. Ils ont été nombreux à reconnaître sa valeur et l’ont apprécié. Toutefois, il y en a qui m’ont affirmé que « la capacité d’autodétermination des patients était faible. Même s’ils ont accepté d’être filmés, il ne faut pas exposer leur visage ». Je crois que la façon dont le personnel soignant s’occupe des patients joue beaucoup sur la manière de recevoir ce film.
Que faudrait-il faire pour améliorer le sort des patients atteints de troubles mentaux ?
S. K. : Même si les personnes qui souffrent de troubles mentaux préfèrent vivre en dehors de l’hôpital que dans un établissement spécialisé, celles-ci ne peuvent compter sur presque rien. Aux alentours de Chorale Okayama, les soins et les aides dépendent seulement de la bonne volonté et des efforts de bénévoles, du personnel soignant et des médecins. Il faudrait que l’Etat les soutienne et mette en place des structures. Le plus souhaitable serait que le patient puisse choisir la forme de traitement tout en continuant à vivre dans la région qu’il connaît. Puisque n’importe qui peut être un patient, ce serait de mettre en place un environnement qui ne sera pas réservé à des gens particuliers mais qui sera pour tout le monde, y compris moi.
Propos recueillis par Claude Leblanc