Sans eux, la plupart d’entre nous ne pourraient pas avoir accès à la littérature japonaise. Sans eux, certains écrivains nippons n’auraient jamais été publiés en dehors de l’Archipel. Je ne parle pas ici des éditeurs qui font, nous le savons, un travail remarquable. Je veux parler de ces femmes et ces hommes dont le nom apparaît en petit sur la couverture quand ils ont cet honneur ou, comme c’est souvent le cas, simplement en page 3. Vous avez compris, il s’agit des traductrices et des traducteurs grâce auxquels on peut profiter de la richesse littéraire venue du monde entier, et du Japon en particulier dans le cas qui nous intéresse. 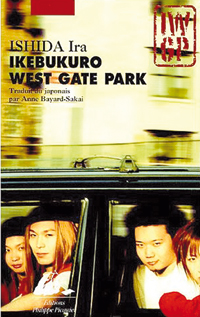 En 2005, Corinne Atlan, traductrice émérite de littérature japonaise, a publié un essai très intéressant sur le métier de traducteur dans lequel elle tentait d’expliquer toutes les difficultés liées à cet exercice. Sous le titre Entre deux mondes (éd. Inventaire-Invention), cet opus mettait en évidence les différences essentielles qui peuvent exister entre les littératures occidentale et japonaise. L’auteur insistait sur « cette absence de frontière entre rêve et réalité, cette intéraction entre intérieur et extérieur, reposant sur l’idée bouddhique que le monde est un reflet qui renvoie chacun à sa réalité intérieure ». Une approche littéraire qui amène les traducteurs à se poser de nombreuses questions lorsqu’il s’agit de « rendre » en français « une autre caractéristique de la littérature japonaise, celle d’une forme de pensée et d’écriture qui préfère la juxtaposition à la logique linéaire, la description du détail à celle de l’ensemble ».
En 2005, Corinne Atlan, traductrice émérite de littérature japonaise, a publié un essai très intéressant sur le métier de traducteur dans lequel elle tentait d’expliquer toutes les difficultés liées à cet exercice. Sous le titre Entre deux mondes (éd. Inventaire-Invention), cet opus mettait en évidence les différences essentielles qui peuvent exister entre les littératures occidentale et japonaise. L’auteur insistait sur « cette absence de frontière entre rêve et réalité, cette intéraction entre intérieur et extérieur, reposant sur l’idée bouddhique que le monde est un reflet qui renvoie chacun à sa réalité intérieure ». Une approche littéraire qui amène les traducteurs à se poser de nombreuses questions lorsqu’il s’agit de « rendre » en français « une autre caractéristique de la littérature japonaise, celle d’une forme de pensée et d’écriture qui préfère la juxtaposition à la logique linéaire, la description du détail à celle de l’ensemble ».
C’est pour avoir su accomplir ce tour de force qu’Anne Bayard-Sakai et Jacques Lévy sont aujourd’hui récompensés par le 17ème prix Noma pour la traduction de la littérature japonaise décerné par l’éditeur nippon Kôdansha qui a compris l’importance de soutenir cette performance — oui, c’en est une — en remettant depuis 1989 une somme rondelette (10 000 dollars) et un billet d’avion au cours d’une belle cérémonie. Cette année, elle aura lieu, le 12 octobre à 18h, à la Maison de la culture du Japon à Paris (MCJP). Plus que l’argent, ce qui compte, c’est la reconnaissance de la profession de traducteur, « ce lecteur privilégié d’un texte que, par la force des choses, il aura lu plus attentivement que n’importe quel autre lecteur », comme le rappelle Anne Bayard-Sakai que l’on récompense pour sa traduction du roman d’Ishida Ira, Ikebukuro West Gate Park (éd. Philippe Picquier). Si ce prix lui permet « d’échapper à la solitude du traducteur », il offre à Jacques Lévy, qui l’obtient pour sa traduction du roman de Nakagami Kenji, Miracle (éd. Philippe Picquier), l’occasion de prendre conscience de son rôle clé dans « la transmission d’un moment crucial de la modernité littéraire japonaise ». C’est la troisième fois après 1991 et 1998 que le prix Noma est remis à des traducteurs en langue française. Gageons que ce ne sera pas la dernière fois.
Claude Leblanc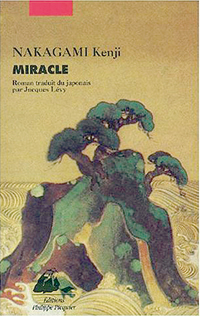
A l’occasion du prix Noma, Kôdansha a décidé d’offrir des livres pour 1 million de yens à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) et la bibliothèque de la MCJP. Si l’on peut saluer le geste envers la BULAC, on peut regretter que l’éditeur n’ait pas choisi de soutenir d’autres structures que la MCJP, organisme officiel nippon. En effet, il existe de nombreux centres qui se démènent pour promouvoir la culture japonaise, mais qui ne disposent pas des moyens de la MCJP. C’est bien dommage.







